
L’eau et la fin des Mayas
14 avril 2023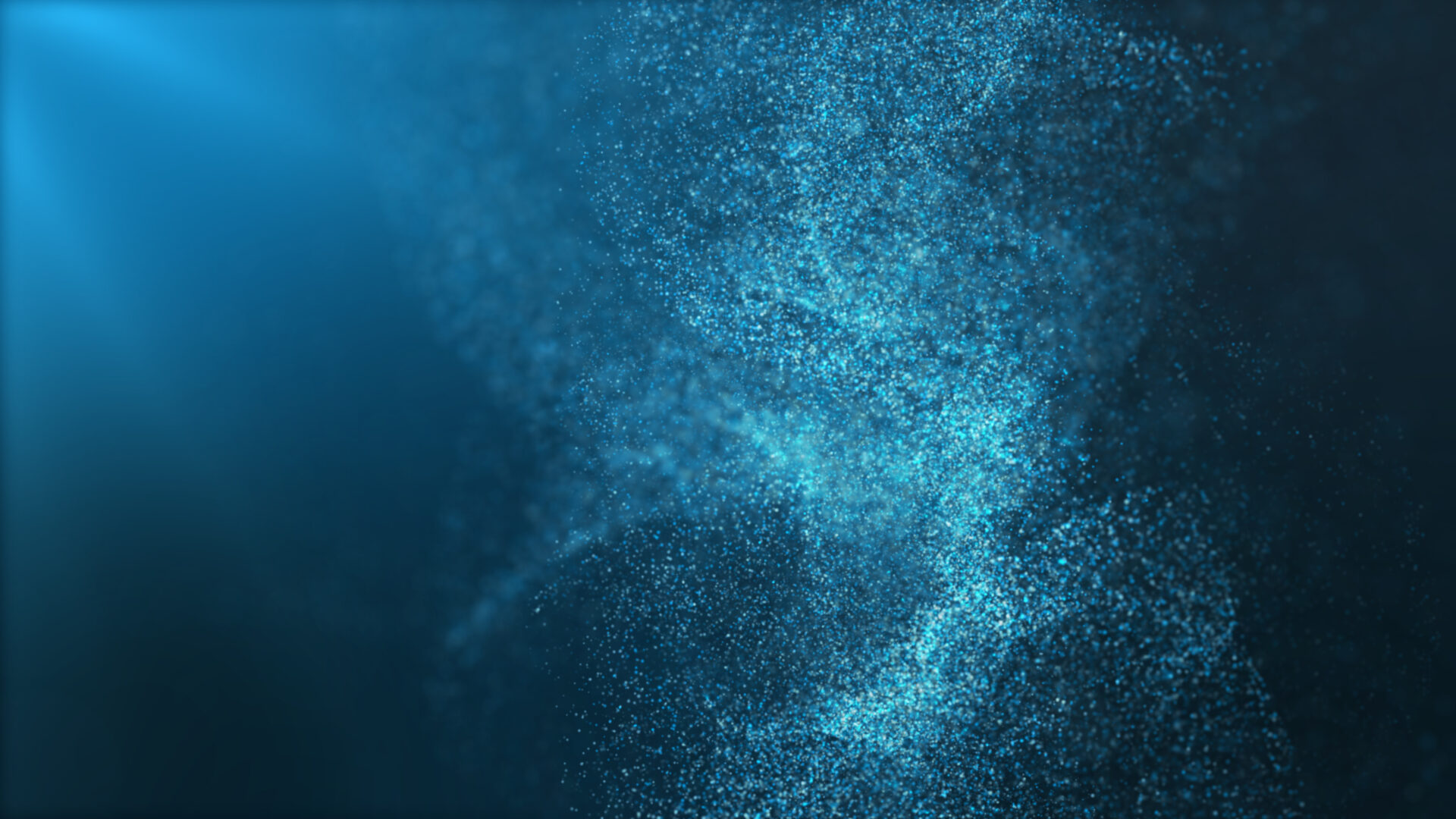
Les aspects scientifiques méconnus de l’eau
20 juin 2023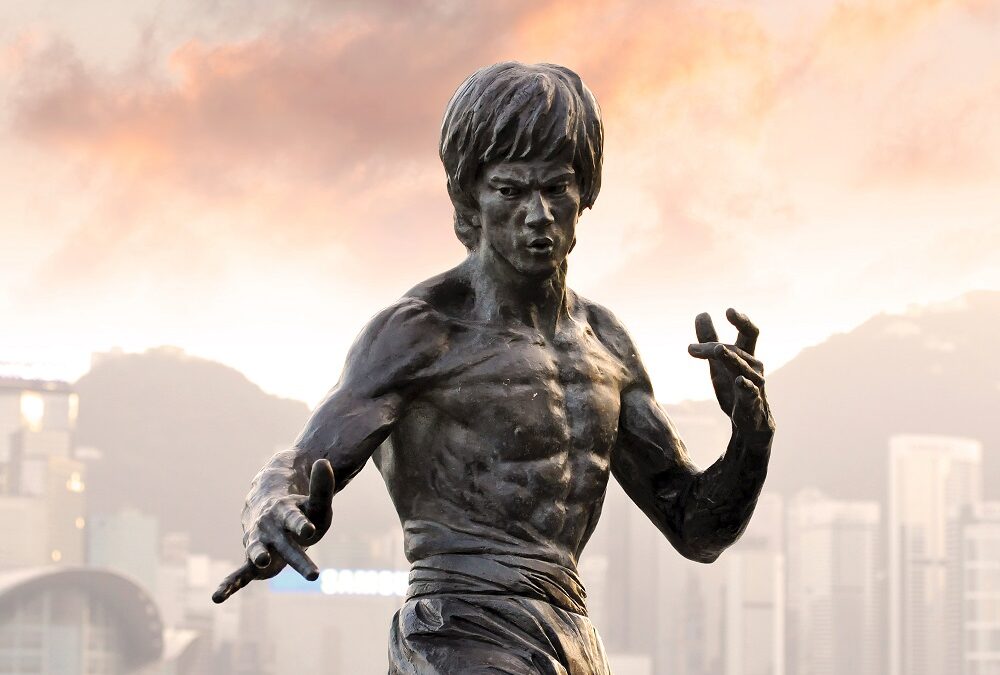
Savoir agir à l’image de l’eau
« Be water my friend » – Bruce Lee
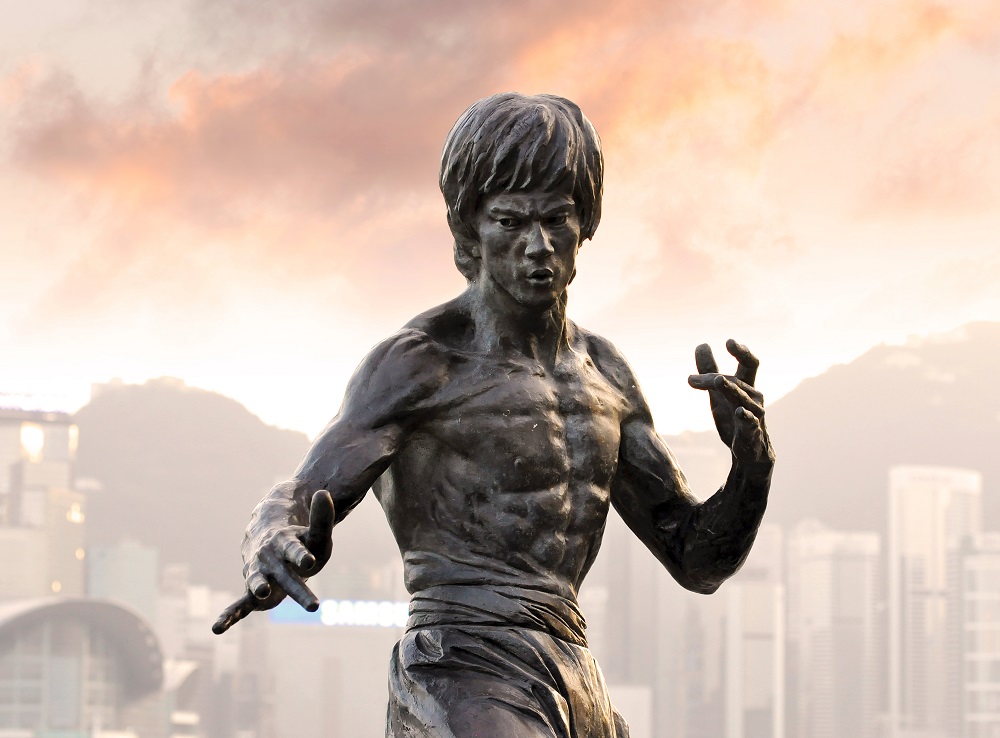
Bruce Lee est une icône majeure dans le monde du cinéma d’arts martiaux, qui a popularisé le kung-fu avec la poignée de films qu’il a pu tourner, au point que tout le monde aujourd’hui connaît ses postures célèbres, ses cris aigus et sa vitesse de frappe prodigieuse.
Mais cette iconographie qui alimente une mythographie du personnage quasi-fantasmatique (nombreux sont ceux qui débattent de son invulnérabilité au combat et de ses capacités prétendument inégalables) dissimule le travail de réflexion philosophique qu’il a mené en écrivant de nombreux livres abordant la martialité et le rapport au combat comme un art de vivre qui engage l’entièreté de l’être dans une forme de dépassement de soi.
Bruce Lee a par ailleurs étudié la philosophie à l’université de Washington et a reconnu avoir été marqué par les sagesses du taoïsme, du bouddhisme ainsi que par l’enseignement de Krisnamurti. On peut ainsi évoquer parmi ses citations inspirantes : « A martial artist does not live for. He simply lives » (un artiste martial ne vit pas pour quelque chose. Il vit tout simplement).
Cependant, sa citation la plus connue, liée à une interview de 1971, souligne l’intérêt d’adopter en combat l’aptitude de l’eau à s’adapter à son environnement pour réagir de la façon la plus efficace à ce qui survient :
« Be water my friend » (sois comme l’eau, mon ami)
C’est la portée philosophique de cette propriété que l’on s’amusera à déployer brièvement dans cet article, sans pour autant la réduire au contexte martial.
1. L’absence de forme figée

La première chose que souligne Bruce Lee dans cette interview, c’est le fait que la liquidité même de l’eau lui permet de n’avoir aucune forme précise et de s’adapter systématiquement à tous ses contenants. Ce qui est surtout vrai à notre échelle, puisqu’une fourmi peut contempler une goutte d’eau comme une structure relativement solide à laquelle elle peut boire sans la défaire.
Évidemment, l’organisation de notre structure corporelle, avec son architecture squelettique interne rigide, ne permet pas de reproduire une telle capacité à adopter n’importe quelle forme. Il faut donc interpréter l’exigence d’agir comme l’eau comme une voie de déconditionnement, au sens où le conditionnement consiste à mobiliser des réponses préfigurées ou pré-formatées de façon systématique, sans les choisir de façon pleinement consciente.
À cet égard, se comporter comme l’eau signifie cultiver la capacité à accueillir, à partir d’un rapport temporel qui est celui de l’instant présent, ce que le réel ou une personne propose à notre encontre. Le terme « accueillir » se distingue de ses synonymes « accepter » ou « subir » en ce que l’accueil relève d’une démarche qui engage davantage la volonté – plutôt que le fait de traverser passivement un événement.

Tout l’enjeu réside évidemment lorsque l’on fait face à une situation dysphorique qui peut confronter à l’intolérable. Il est bien sûr normal d’être heurté à l’intolérable, qui limite la capacité à accueillir ce que l’autre peut faire ou peut dire. Cependant, une clef qui permet de développer l’aptitude à réagir de façon vivante d’instant en instant consiste à d’abord accueillir les réactions qui se produisent en nous, avant de pouvoir tourner notre attention vers ce qui passe à l’extérieur.
2. La valeur de la fluidité
Le corollaire de la liquidité singulière de l’eau est sa fluidité, dont le torrent ou la rivière sont les symboles par excellence.
Elle traduit la vivacité avec laquelle l’eau peut s’adapter aux obstacles qu’elle rencontre, qui en fait une matière difficilement saisissable ou préhensible – c’est pourquoi il est plus facile de la recueillir dans un contenant évidé que de chercher à l’enfermer dans son poing.

À nouveau, cette qualité de l’eau s’interprète comme un symbole et renvoie à la notion de disponibilité. À cet égard, ce n’est pas un hasard si l’eau est un comparant qui interpelle Bruce Lee. Car à l’inverse de l’imaginaire occidental, marqué par la valeur de l’effort pour vaincre les obstacles, l’imaginaire extrême-oriental valorise l’agir plus diffus de l’eau, dont l’action sur la durée est celle qui a le pouvoir d’éroder la pierre.
C’est notamment la valeur du principe du « Yin » dans la tradition taoïste, telle que l’illustre en particulier le Livre des Mutations (Yi-Jing) qui souligne la valeur de l’adaptation à l’aspect sans cesse mouvant du réel (voir notre article sur la symbolique du puits à ce sujet).
La sagesse extrême-orientale est à cet égard moins tournée vers les questions de volonté et de libre arbitre qui traversent la sensibilité occidentale qu’elle ne privilégie les questions d’efficacité et de justesse dans l’action.

La disponibilité est à cet égard le contraire de la tension, qu’elle soit d’ordre physique (en empêchant de se mouvoir librement) que psychologique (en empêchant d’accueillir la singularité de l’autre).
La difficulté est qu’une telle aptitude peut engendrer une forme de tension pour la maintenir à tout prix face à ce qui peut heurter. Une clef pour éviter de faire de cette exigence un fardeau consiste à faire le deuil de pouvoir maintenir cette disponibilité en toutes circonstances, de façon à garder en soi un espace de détente même s’il reste d’ordre relatif.
3. Ne pas perdre de vue la compacité
Les deux valeurs précédentes ne doivent cependant pas occulter la propriété de l’eau d’être une matière incompressible. Si certes elle se caractérise en premier lieu par sa liquidité, sa déformation est soumise aux lois de la visquosité qui fait que si on percute violemment l’eau, celle-ci peut se présenter comme un véritable mur. Au point qu’il est possible d’en faire des lasers pour découper du béton ou du métal.
Bruce Lee évoque cette propriété en précisant que l’eau peut « écraser ». Car il est évident, du point de vue de sa pratique martiale, que pouvoir s’adapter à son adversaire sans être en mesure de le terrasser faute de puissance ne sert à rien. Par extension, il faut prendre en compte un danger à cultiver de façon excessive l’aptitude à s’adapter, au risque de se conformer ou de subir les exigences des autres, qui peuvent êtres infinies.
Ce qui est en jeu ici est la fermeté, qui permet de pouvoir dire non aux propositions que l’on nous fait qui ne nous conviennent pas sans devoir céder – en mesurant que la friction est inévitable dans les relations du fait de nos différences. Elle est nécessaire pour développer un usage protecteur de la force, comme l’évoque Martin Luther King dans cette citation :
« Le pouvoir sans amour est dangereux et abusif ; mais l’amour sans pouvoir est sentimental et anémique ».

Car il peut y avoir une tentation, naturelle, à ne pas se risquer dans une confrontation avec autrui, ne fût-ce que par désir de prendre soin de la relation. Mais le risque est de se retrouver, dans certaines configurations extrêmes, à la merci d’êtres qui, parce qu’ils sont blessés, peuvent agir d’une façon qui ne contribue absolument pas à notre épanouissement. Et à nous acculer dans une position douloureuse de victime.
*
* *
Au terme de cette rapide réflexion sur la dimension symbolique que véhicule l’eau, on se retrouve face à un paradoxe consistant à intégrer des valeurs a priori incompatibles : l’accueil et la fluidité d’une part avec la fermeté d’autre part. Et c’est là en dernier lieu l’intérêt d’un symbole aussi polymorphe que l’eau : il ouvre à une réponse qui, loin d’être univoque, est complexe et maintient ouvert un questionnement fécond sur la façon d’agir au mieux.
Ce caractère paradoxal peut se résumer en ceci : le fait de pouvoir agir à cœur ouvert, même et surtout face à l’adversité ; c’est-à-dire d’être en mesure si nécessaire de faire un usage de sa force qui peut confiner à la violence si les circonstances l’exigent (comme intervenir pour protéger une personne d’une agression) mais sans être pris dans une logique d’ennemis, laquelle conduirait à éprouver une forme de joie mauvaise à exercer de la violence.
Cette complexité a l’avantage de faire fonctionner l’eau comme un horizon spirituel vers lequel tendre, au sens où tout l’enjeu consiste à agir spontanément de la manière la plus adéquate, plutôt que comme un possible qui serait aisément à notre portée et qui ne dépendrait que de notre volonté pour être atteint.
Ce qui fait écho à ce détail amusant rapporté par l’un des contributeurs du site « booska-p.com » consacré à la culture pop, selon lequel Bruce Lee ne savait pas nager. Un détail qui n’est pas anodin, au sens où il vient souligner la frontière entre les qualités spirituelles auxquelles on peut aspirer (l’infinie disponibilité et l’infinie équanimité) et le fait que notre humanité réside dans l’épreuve de nos limites – obligeant à acquérir cette sagesse de savoir renoncer à nos élans parfois démesurés en regard de la finitude de nos moyens.
